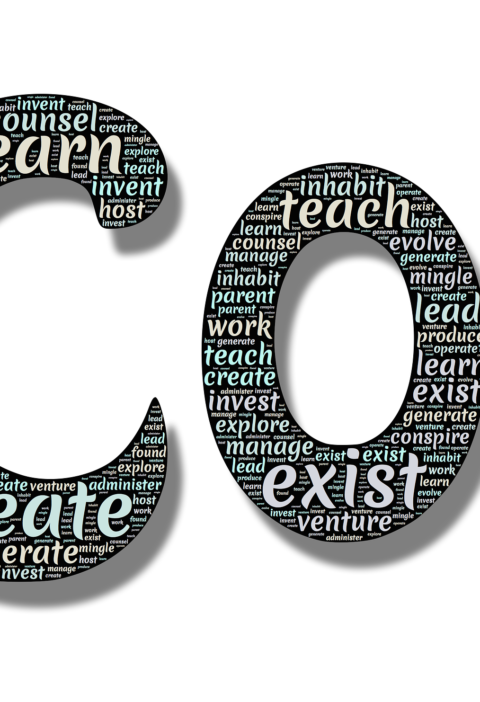Dès le début des années 2000, des auteurs montrent que dans la cadre des innovation environnementale la dynamique de marché à elle seul n’est pas suffisante. Rennings (2000) soutient l’idée que même si les déterminants classiques de l’innovation jouent un rôle clé, les innovations environnementales sont également impulsées par un double effet réglementaire. Il considère en effet qu’il faut ajouter aux déterminants classiques de l’innovation, « demand pull » et de « technology-push », un troisième déterminant appelé « regulatory push-pull effect ».
Double externalité et incertitude
Pour justifier son hypothèse, il met en évidence que, contrairement aux innovations classiques, les innovations environnementales sont caractérisées par « une double externalité », à la fois dans la phase d’innovation et dans la phase de diffusion, car ces innovations produisent non seulement des externalités de connaissances, mais aussi des externalités positives liées à la composante de bien public qui caractérise les biens environnementaux. Ainsi, en améliorant la qualité de l’environnement, la diffusion des innovations environnementales est toujours socialement désirable. Dès lors, cette double dimension limite les incitations privées des entreprises à financer et adopter ces innovations car elles ne peuvent capturer toute la valeur générée. Par ailleurs, Rennings (2000) montre également que, dans le cadre des technologies moins polluantes, le consommateur rencontre des difficultés à appréhender les caractéristiques environnementales lors de sa décision d’achat ; ce qui réduit son consentement à payer pour ce type de biens. En effet, les technologies environnementales revêtent un double statut de biens d’expérience et de biens de croyance dans la mesure où la vérification par le consommateur est difficile, aussi bien lors de l’utilisation qu’après l’utilisation (Tankam et al. 2019). Il semble complexe pour le consommateur de trouver ex ante des informations fiables, et difficile de valider ces informations, même après consommation, sauf à très long terme. La plupart du temps, le consommateur n’est pas en mesure d’évaluer la qualité environnementale et sanitaire du produit consommé. Il fait donc face à une incertitude forte et souvent persistante quant à la qualité environnementale du produit qu’il achète ; ce qui a pour conséquence de limiter l’attractivité de ce type de biens. Dans un tel contexte, les réglementations environnementales jouent un rôle central dans le développement des technologies moins polluantes. Elles font naître un double effet réglementaire (Rennings, 2000) qui prend la forme d’un effet regulatory-push, en favorisant de nouvelles opportunités dans le développement des innovations environnementales ; et d’un effet regulatory-pull, en améliorant la sensibilité de la demande aux caractéristiques environnementales.
Des études empiriques divergentes
Sur le plan empirique, les études menées sur la relation entre réglementation environnementale et innovation conduisent à des résultats contradictoires. Il n’existerait pas de relation systématique entre réglementation, compétitivité et innovation. Ambec et al. (2013) montrent que les cas où « ça marche » sont aussi nombreux que les cas où « ça ne marche pas ». Cette controverse sur les résultats empiriques est en partie liées au fait que l’impact de la réglementation sur la dynamique technologique dépend de la nature de la réglementation environnementale. Nos travaux (Arfaoui et al 2014., Brouillat et al. 2018) montrent que le débat a, dans un premier temps, porté sur le choix des instruments politiques. Pendant longtemps les instruments économiques, comme les taxes et les permis négociables, ont été considéré comme supérieurs, c’est-à-dire comme ayant une efficacité dynamique en termes d’innovation plus élevée. Leur avantage est qu’ils créent des incitations permanentes à la réduction des impacts environnementaux, car en agissant sur les prix ils permettent de réorienter la production vers des technologies moins polluantes. Dans un cadre d’analyse coût-avantage, les instruments économiques sont plus efficaces que les instruments de type commande and control. Cependant, ce résultat n’est confirmé que dans une approche néoclassique qui appréhende le changement technique comme la conséquence du comportement rationnel des producteurs consistant à maximiser leur profit ou leur productivité dans le cadre d’une structure de marché donnée. Au contraire, dans les modèles évolutionnistes, où la technologie est définit comme un processus cumulatif d’essais-erreurs, la supériorité des instruments de marché est remise en question. Dans cette approche, en effet, les différents instruments de type command and control peuvent également être appropriés pour stimuler des innovations environnementales. Les instruments réglementaires sont à priori plus à même d’engendrer une transformation du « paradigme technologique » existant nécessaire pour atteindre des objectifs de soutenabilité. Quant aux instruments économiques ils se montreraient plus appropriés pour encourager des changements incrémentaux et la diffusion de nouvelles technologies. Toutefois, ces résultats ne représentent que des tendances générales et ne traduisent aucune relation systématique.
Le rôle clef du policy design : sévérité, flexibilité et timing
L’approche évolutionniste reconnaît donc que le débat s’est cristallisé autour de la sélection d’un type d’instrument de politique environnementale, alors que des facteurs autres que le simple choix de l’instrument influencent l’efficacité de la politique environnementale. Or, il serait plus pertinent de faire porter le débat sur les caractéristiques des instruments qui assureraient le succès des politiques environnementales. La question qui se pose alors est celle de savoir quelles sont les conditions qui favoriseraient le développement des technologies environnementales. Dans cette perspective, de nombreux auteurs soulignent l’importance des attributs du policy design dans le développement des technologies environnementales. Les critères tels que la sévérité, la flexibilité ou encore le timing sont des éléments essentiels du policy design qui vont influencer le processus d’innovation dans le domaine de l’environnement et de la santé.
Références
Arfaoui, N., Brouillat, E., & Saint Jean, M. (2014). Policy design and technological substitution: Investigating the REACH regulation in an agent-based model. Ecological Economics, 107, 347-365.
Brouillat, E., Saint Jean, M., & Arfaoui, N. (2018). “Reach for the sky”: modeling the impact of policy stringency on industrial dynamics in the case of the REACH regulation. Industrial and Corporate Change, 27(2), 289-320.
Kemp, R., & Pontoglio, S. (2011). The innovation effects of environmental policy instruments—A typical case of the blind men and the elephant?. Ecological economics, 72, 28-36.
Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological economics, 32(2), 319-332.
Tankam, C., Vollet, D., & Aznar, O. (2019). Entre asymétrie d’information et incertitude partagée. Analyse des systèmes de certification biologique pour le marché domestique kenyan. Economie rurale, 63-81.