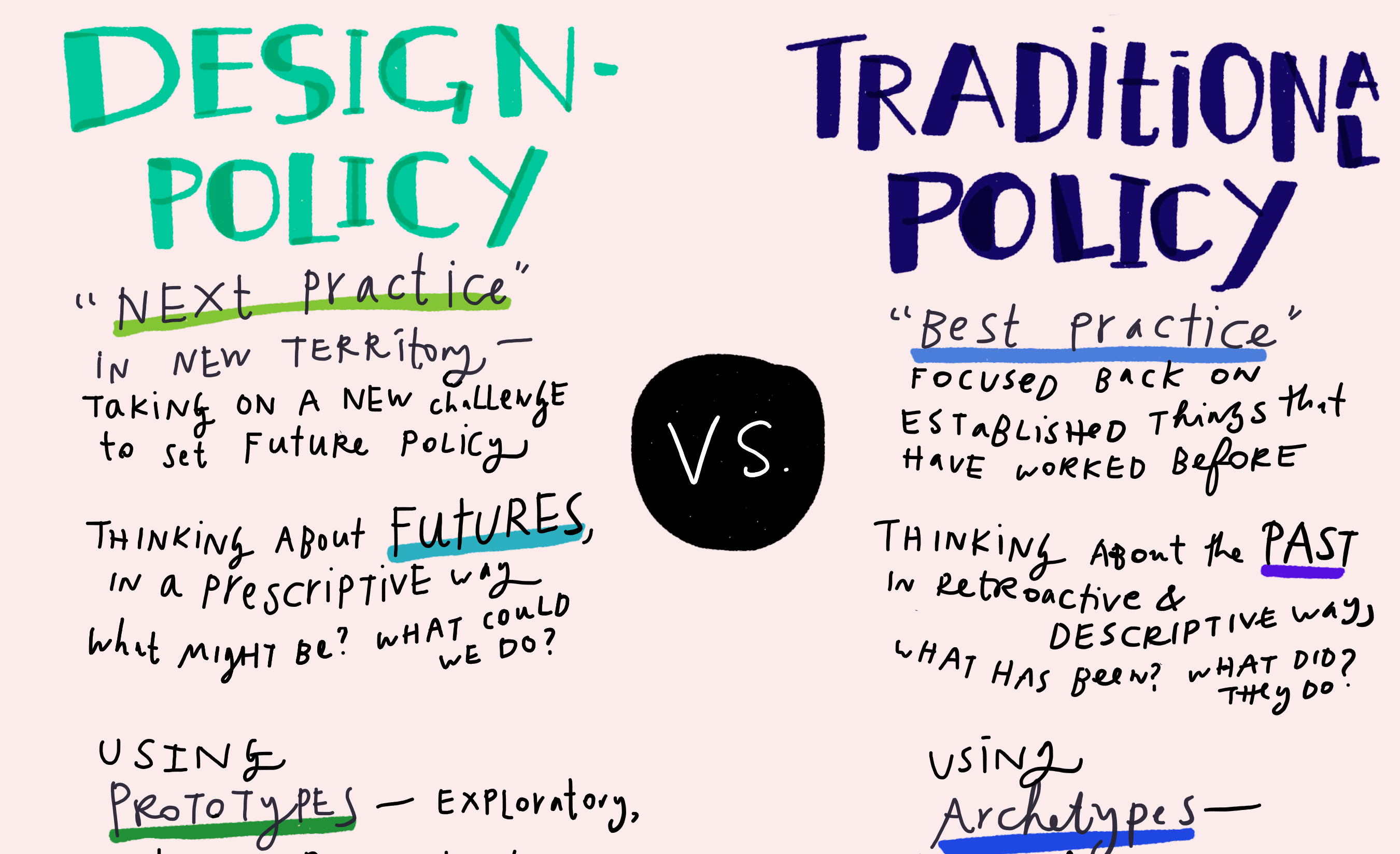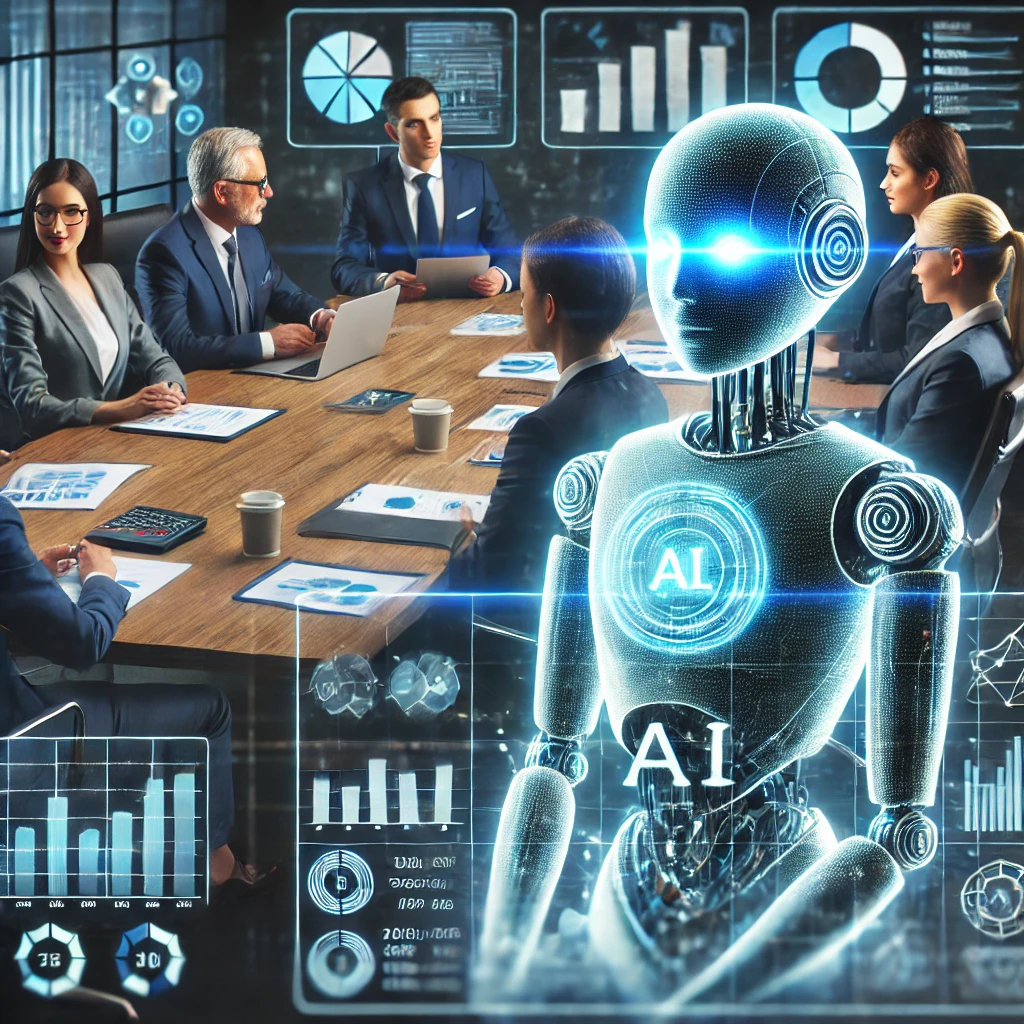Selon la littérature, l’innovation sociale peut être synthétiquement définie sous trois formes (Billion, 2024). Premièrement, elle constitue une réponse à une problématique sociale en visant à proposer des solutions adaptées. Le groupe ciblé peut inclure aussi bien des populations marginalisées que non marginalisées. Deuxièmement, elle vise à satisfaire des besoins sociaux tout en favorisant l’émergence de nouvelles idées. Troisièmement, elle combine ces deux approches, considérant ainsi l’innovation sociale comme un processus à la fois de réponse aux enjeux sociaux et de création de solutions inédites. Le terme « social » renvoie alors aux rapports sociaux, à l’intégration dans la vie collective et à la dynamique d’appropriation des innovations par un groupe. L’innovation inclusive, quant à elle, constitue une forme spécifique d’innovation sociale, dont l’objectif est de favoriser l’inclusion des populations traditionnellement exclues. Elle repose sur un processus participatif impliquant directement ces groupes, tels que les personnes en situation de handicap, les minorités ethniques, les personnes âgées, les jeunes, les femmes ou encore les habitants de territoires marginalisés. L’innovation inclusive vise ainsi à améliorer leur qualité de vie en réduisant les inégalités et en favorisant leur accès aux droits fondamentaux (Peyrard, 2022).
Ces deux concepts présentent plusieurs similitudes. L’intérêt scientifique et politique pour l’innovation sociale et, plus récemment, pour l’innovation inclusive, s’est accru de manière significative. Ces innovations partagent une finalité commune : générer du changement, favoriser l’émergence de nouvelles pratiques et transformer les dynamiques sociales. Elles induisent des évolutions en matière d’attitudes, de comportements, de perceptions et de pratiques collectives. Orientées vers le progrès social plutôt que vers la recherche du profit, elles visent un impact collectif et des bénéfices sociétaux. Elles se traduisent à la fois par des processus et des résultats concrets, pouvant prendre la forme de biens, de services, de modèles, ou encore d’innovations technologiques, culturelles, organisationnelles, juridiques et infrastructurelles. Elles opèrent à différents niveaux – organisationnel, institutionnel et sociétal – et s’inscrivent toujours dans un contexte spécifique, marqué par une diversité d’acteurs et d’environnements. Le développement de l’innovation sociale et de l’innovation inclusive s’observe au sein d’organisations variées, qu’il s’agisse du secteur privé, public ou associatif (entreprises, ONG, acteurs individuels), dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Bien que ces concepts s’ancrent dans un cadre théorique en construction, leur définition demeure encore sujette à débat. De surcroît, ils mobilisent des approches interdisciplinaires, notamment en sociologie, psychologie et sciences de gestion, ce qui enrichit leur compréhension tout en complexifiant leur délimitation théorique.
Ces deux concepts présentent également des divergences notables (Billion, 2024). La littérature scientifique sur l’innovation sociale est incontestablement plus développée que celle portant sur l’innovation inclusive. Paradoxalement, le concept d’innovation sociale apparaît plus flou et moins abouti que celui d’innovation inclusive. En effet, l’innovation sociale ne vise pas nécessairement des populations marginalisées, contrairement à l’innovation inclusive, qui s’adresse spécifiquement aux publics exclus. De plus, l’innovation sociale ne requiert pas systématiquement la participation des bénéficiaires à la conception du projet, alors que la co-construction est une caractéristique essentielle de l’innovation inclusive. Ainsi, Dès lors, lorsqu’une innovation cible des populations marginalisées, le recours au concept d’innovation inclusive apparaît plus pertinent et précis et ce pour quatre raisons principales. Premièrement, l’innovation sociale, par sa portée très large, ne délimite pas clairement son objet d’étude, ce qui peut entraîner une confusion avec le concept d’innovation en général, dans la mesure où toute innovation a un impact sur la vie en société. Bien que l’innovation sociale et l’innovation inclusive poursuivent des objectifs similaires – orienter le processus d’innovation vers l’action et les effets concrets sur l’amélioration des conditions de vie (Patiño-Valencia et al., 2020) – elles diffèrent dans leur degré de précision. Deuxièmement, ces deux concepts se distinguent par leurs finalités. L’innovation inclusive vise explicitement à réduire, voire à éliminer, les situations de vulnérabilité, alors que l’innovation sociale ne poursuit pas nécessairement cet objectif. Troisièmement, l’innovation inclusive repose sur un principe fondamental de participation des populations exclues, qui sont directement impliquées dans la co-construction des solutions. Cette approche s’avère essentielle, car ces populations sont les mieux placées pour comprendre et définir les enjeux auxquels elles sont confrontées. Il semble donc difficile de concevoir une innovation inclusive sans leur implication active. Quatrièmement, la recherche sur l’innovation inclusive est plus récente que celle sur l’innovation sociale, ce qui en fait un champ d’étude plus novateur. Son caractère émergent ouvre des perspectives importantes en matière de production de connaissances et d’exploration scientifique.
Bibliographie
Billion J. (2024). Handicaps. De l’innovation sociale à l’innovation inclusive. Suresnes: INSEI/Champ social éditions.
Patiño-Valencia, B., Luisa Villalba-Morales, M., Acosta-Amaya, M., Villegas-Arboleda, C. and Calderón-Sanín, E. (2020), “Towards the conceptual understanding of social innovation and inclusive innovation: a literature review”, Innovation and Development, Vol. 12, pp. 437-458.
Peyrard, E. (2022), L’innovation inclusive en pratique : fondations, apports et défis dans le domaine du handicap, Thèse de doctorat en sciences de gestion de l’Institut Polytechnique de Paris.