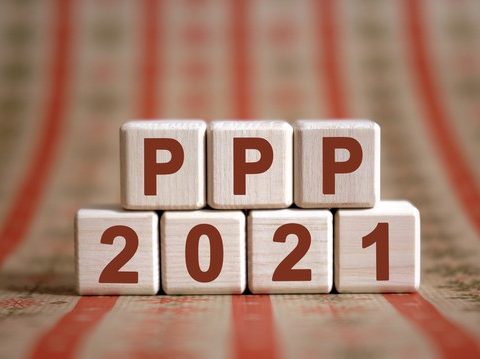À l’ère de l’anthropocène, l’alimentation représente l’un des plus grands défis santé et environnemental du XXIe siècle. L’agriculture intensive, bien qu’ayant permis de passer d’un système de pénurie à un système d’abondance et de réduire la faim dans le monde, a de nombreux effets négatifs sur l’environnement et la santé et contribuent au réchauffement climatique. La monoculture, l’utilisation d’intrants chimiques et de pesticides, ainsi que la mécanisation intensive affaiblissent les sols, polluent les ressources en eau et réduisent fortement la biodiversité. En France, l’agriculture participe ainsi à 19 % des émissions de gaz à effet de serre. Le modèle agricole actuel impacte également directement ses acteurs. Les écarts de revenus sont élevés entre les différentes filières et la crainte du non-remplacement des agriculteurs, une population vieillissante d’actifs, inquiète le secteur. Pourtant, l’agriculture possède des atouts naturels lui permettant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la résilience de la biodiversité. Selon le GIEC, une décarbonation à hauteur de 44 % est possible grâce à des solutions déjà existantes. La transition vers des pratiques agricoles durables s’opère déjà chez certains agriculteurs et éleveurs. Les exploitations agricoles biologiques, par exemple, sont plus performantes et rémunératrices à superficie comparée. Ces pratiques favorisent la qualité des aliments et renforcent le lien social entre producteurs et consommateurs en vendant une partie importante de leur production en circuits courts. Cependant, ces évolutions ne sont pas suffisantes et doivent être complétées par des transformations structurelles pour réduire fortement les impacts des activités agroalimentaires sur le réchauffement climatique et revaloriser socialement comme économiquement les agriculteurs, notamment ceux des filières faiblement rémunératrices. Si la loi « Duplomb » a, récemment, « fait parler la poudre » et renforcera les tensions entre les parties prenantes aussi bien internes au monde agricole qu’externes en s’exonérant des impératifs transformationnels que nécessitent les impacts connus du réchauffement climatique sur les pratiques agricoles et en oubliant la plupart des revendications exprimées par les agriculteurs en 2024, un autre cheminement existe et devrait être, à tout le moins, systématiquement considéré : les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont un outil essentiel pour mettre en place une synergie résiliente des systèmes agricoles et de transition du système alimentaire. Un PAT se définit, selon Jean-Louis Rastoin, comme un « ensemble de filières agroalimentaires localisées dans un espace géographique de dimension régionale et coordonnée par une gouvernance territoriale ». Il repose sur la logique de proximité, favorisant les échanges matériels et immatériels et permettant de mutualiser les ressources locales en intégrant les critères du développement durable. Ce dispositif, issu de la Loi d’avenir, de l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, est construit sur la base d’une initiative locale, le projet, s’appuyant sur un diagnostic partagé des acteurs au niveau régional (le territoire). En étant pensé à petite échelle de manière collective, il permet de tenir compte des attentes et des contraintes d’un territoire pour articuler résilience environnementale, cohésion sociale et souveraineté alimentaire. Les PAT ont ainsi pour objectif d’accompagner la transition des systèmes agricoles et alimentaires vers des modèles plus durables. Ils encadrent des projets concrets en matière d’éducation alimentaire, de foncier agricole, de restauration collective, de nutrition et santé, de justice sociale, de structuration des filières (territorialisation, circuits courts) et d’environnement (préservation de l’eau et de la biodiversité, par exemple). En 2025, la France compte 448 PAT regroupant des acteurs de la recherche, des chambres d’agriculture, des communes, des associations et des acteurs économiques.
Les PAT visent donc à relocaliser les circuits alimentaires, en raccourcissant la distance entre production, transformation et consommation. Cette approche renforce la sécurité alimentaire en diminuant la dépendance aux filières longues et aux énergies fossiles. Elle favorise aussi la valorisation des coproduits (bioénergie, biomatériaux) et stimule les initiatives de type « circuit court ». Cette dynamique doit permettre aux PME et TPE de renforcer leur activité économique, sinon de se relocaliser et donc d’accroître le taux d’emploi local et la diversité économique. Les chaînes courtes ainsi créées ou renforcées, en étant moins carbonées et plus réactives face aux aléas climatiques – inondations, gel, sécheresse, sont en capacité d’adopter des solutions locales et flexibles. Cela fait du PAT un vecteur d’adaptation aux changements, quels qu’ils soient. Les PAT mettent aussi en pratique la gouvernance polycentrique, essentielle à la résilience et la transition des systèmes complexes. Les projets proposés s’appuient sur des objectifs compris et acceptables, traduisant le « goût » du territoire et favorisant l’implication d’un grand nombre d’acteurs. Ils respectent les modes de production des innovations des sociétés humaines, loin du credo de la globalisation favorable aux intérêts de grandes entreprises internationales et aux longues chaînes de valeurs sur lesquelles reposent leurs activités économiques. Les PAT intègrent, également, la nécessité de la transition juste, en réorientant les flux financiers vers des solutions productives et en densifiant le tissu d’entreprises des territoires. Ils proposent des actions concrètes et rapidement réalisables tout en tenant compte des enjeux de résilience et de transition que le réchauffement climatique impose régionalement. De fait, le PAT forme un micro SAT (Système Alimentaire Territorial) qui en regroupera plusieurs. En effet pour être viable, le territoire d’un SAT hébergeant des PAT doit regrouper 1 à 5 millions d’habitants et des agglomérations de moins de 500 000 personnes afin que proximité et performance économique puissent se matérialiser dans la logique de soutenabilité attendue à l’ère de l’anthropocène.
La mise en réseau des acteurs d’un territoire ou d’une région dans une logique de durabilité et de circularité économique n’exclut pas les relations économiques extra-régionales, aucun territoire n’étant autonome, notamment au niveau alimentaire. Par ailleurs, il est nécessaire que l’ensemble des parties prenantes s’approprient et acceptent les PAT. L’adaptation des projets aux contraintes territoriales et la discussion autour des initiatives qui y sont portées sont ainsi essentielles pour que ces initiatives soient couronnées de succès. Elles présentent cependant un avantage socio-économique certain car elles sont fondées sur l’expérimentation et l’apprentissage collectif qui permettent de les faire évoluer rapidement et de provoquer une transition ascendante ressentie et acceptée par le plus grand nombre.