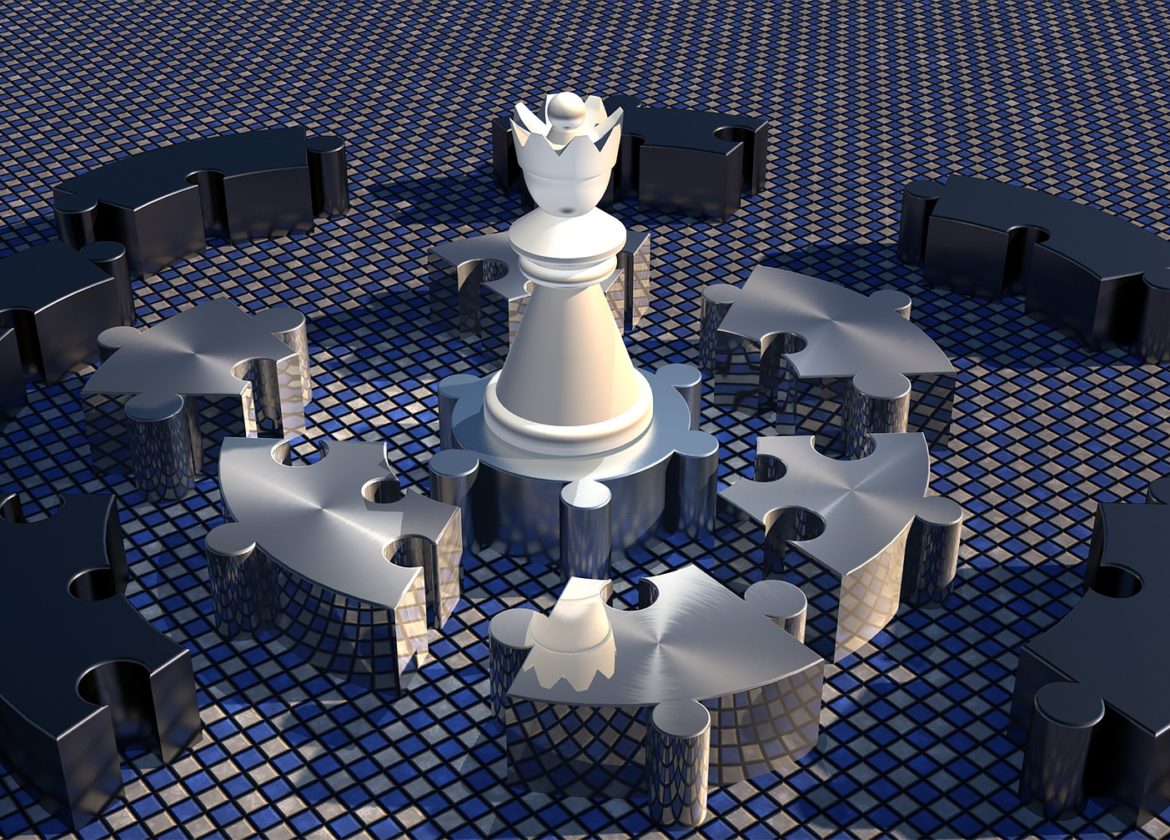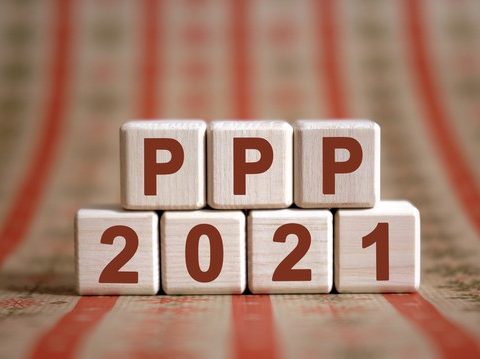Depuis plus d’un siècle, les économistes et les géographes s’intéressent à la manière dont les entreprises se regroupent dans l’espace et aux avantages que cette proximité peut leur apporter. Ce phénomène, appelé agglomération spatiale des activités, a été mis en évidence dès le début du XXe siècle par Alfred Marshall. Celui-ci soulignait déjà que le fait pour des entreprises d’un même secteur d’être situées à proximité géographique favorise la circulation des idées, l’échange de savoir-faire, le recrutement de main-d’œuvre qualifiée et la diffusion rapide de l’innovation. Dans cette perspective, la proximité géographique n’est pas seulement une question de distance, mais aussi un levier de performance économique et d’apprentissage collectif. Être « proche », c’est pouvoir collaborer plus facilement, échanger plus souvent et innover plus rapidement. Au fil du temps, la recherche a élargi cette notion de proximité. On reconnaît désormais que les relations entre acteurs ne reposent pas uniquement sur la distance physique, mais aussi sur des formes de proximité organisée. Cette dernière renvoie aux liens sociaux, institutionnels ou cognitifs qui unissent les acteurs économiques : partager des valeurs, des références communes, des routines de travail ou encore un même langage technique peut créer un sentiment de proximité, même entre entreprises éloignées géographiquement. Comme le rappellent Torre et Rallet (2005), la proximité organisée permet de comprendre pourquoi certaines collaborations sont très efficaces malgré la distance, tandis que d’autres échouent malgré la co-localisation. En d’autres termes, la proximité peut être « ressentie » ou « construite », et non pas seulement « mesurée » en kilomètres.
Ces concepts, bien établis dans le cadre de l’économie linéaire (extraire, consommer et jeter) ont été encore peu explorés dans le contexte de la transition vers une économie circulaire. Or, l’économie circulaire bouleverse cette logique en cherchant à boucler les flux de matière et d’énergie, à réduire le gaspillage et à encourager la coopération entre entreprises, collectivités et citoyens. Dans ce nouveau modèle, les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres, ce qui suppose un haut niveau de coordination et de confiance entre acteurs. Dès lors, la question du rôle de la proximité géographique comme organisée devient centrale : dans quelle mesure être proche (ou se sentir proche) aide-t-il à construire des circuits économiques plus circulaires et plus durables ? À partir d’une enquête menée auprès de 1 000 entreprises, nos travaux (Arfaoui et al. 2024) analysent comment la proximité géographique et organisée influence la mise en œuvre des pratiques d’économie circulaire, selon trois types de modèles : la gestion et la valorisation des déchets, la réduction et la réutilisation des ressources, et enfin l’innovation circulaire et l’éco-conception.
Nos résultats montrent que la proximité entre acteurs joue bien un rôle dans la mise en œuvre de l’économie circulaire, mais pas de la même manière selon les types de pratiques. En d’autres termes, être « proche » aide les entreprises à coopérer, mais cette proximité peut être géographique (travailler avec des partenaires voisins) ou organisée (partager des valeurs, des connaissances ou une vision commune), et son effet varie selon les contextes.
Des besoins de proximité différents selon les pratiques circulaires et la taille de l’entreprise
L’analyse révèle que pour 53% des entreprises qui perçoivent leurs partenaires comme proches géographiquement sont plus actives dans l’économie circulaire. Cette proximité, réelle ou ressentie, facilite la confiance, la communication et la coopération, trois éléments essentiels pour partager des ressources, recycler ou mutualiser des infrastructures. Toutefois, ce n’est pas une règle absolue. Pour certaines entreprises, notamment les plus petites, une trop grande proximité peut devenir un frein particulièrement pour les pratiques circulaires d’innovation et d’éco-conception. Elles préfèrent parfois garder leurs distances pour protéger leurs idées et éviter que des concurrents locaux ne s’en inspirent.
Nos travaux montrent également que les pratiques fondées sur la gestion des déchets ou la réduction et la réutilisation des ressources reposent sur des échanges physiques réguliers entre acteurs. Ces pratiques nécessitent donc des relations de proximité géographique et de confiance, souvent entretenues par des rencontres en face à face. En revanche, les pratiques d’innovation circulaire et d’éco-conception, centrées sur la conception de nouveaux produits ou services plus durables, dépendent moins de la proximité physique. Les collaborations y sont souvent plus dispersées géographiquement et s’appuient davantage sur des compétences techniques que sur la localisation.
La proximité organisée : le rôle clé des acteurs publics
Au-delà de la distance physique, la proximité organisée fondée sur la confiance, les échanges et les valeurs communes est tout aussi importante. De manière générale, plus une entreprise collabore avec un grand nombre de partenaires, plus elle adopte de pratiques d’économie circulaire. Cela confirme que la circularité ne peut pas être portée par des acteurs isolés : elle repose sur un écosystème collaboratif, où les entreprises, les institutions publiques et les structures d’appui partagent des ressources et des connaissances pour réduire les déchets et optimiser l’usage des matières premières. De plus, nos résultats mettent en évidence que les acteurs publics (collectivités, agences, chambres de commerce, etc.) jouent un rôle central dans la création de cette proximité. Ils servent souvent de médiateurs neutres, capables de mettre en relation des entreprises qui n’auraient pas collaboré spontanément. Aussi, nos résultats soulignent l’importance de politiques territorialisées et collaboratives. Les autorités régionales ont un rôle majeur à jouer pour encourager la coopération locale et créer des structures d’intermédiation : pôles territoriaux, parcs de symbiose industrielle, plateformes de mutualisation ou réseaux interentreprises. Enfin, le choix de l’acteur animateur doit s’adapter au type de pratique les acteurs privés sont essentiels pour la gestion opérationnelle des déchets et des flux de matière ; les acteurs publics, eux, sont mieux placés pour encourager l’innovation et la conception durable.
Références
Arfaoui, N., Bourdin, S., Torre, A., Vernier, M. F., & Vo, L. C. (2024). Geographical and organised proximities influencing circular economy practices: the closer partners, the better?. Regional Studies, 58(12), 2485-2500.
Torre, A., & Rallet, A. (2005). Proximity and localization. Regional studies, 39(1), 47-59.