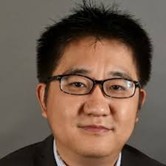Depuis une quinzaine d’années, l’entrepreneuriat féminin est devenu un objet de politiques publiques en France. La multiplication des programmes d’accompagnement, des appels à projets ciblés et des plans nationaux témoigne d’une volonté institutionnelle de soutenir les femmes dans leurs parcours entrepreneuriaux. Cette mobilisation répond à un double constat : d’une part, la sous-représentation persistante des femmes parmi les créateurs et dirigeants d’entreprises, et d’autre part, les obstacles spécifiques qu’elles rencontrent, notamment en matière de financement, de réseaux et de reconnaissance. Pourtant, au-delà des affichages, la question mérite d’être posée : ces politiques répondent-elles réellement aux besoins et aux attentes des femmes entrepreneures ?
C’est ce que nous avons cherché à explorer dans une recherche menée récemment auprès de femmes entrepreneures en France. À travers une enquête qualitative nourrie d’entretiens, d’observations et d’analyses documentaires, nous avons examiné le décalage qui subsiste entre les ambitions des politiques publiques et la réalité des expériences vécues par les entrepreneures.
Nos résultats montrent que si les dispositifs existants offrent indéniablement des opportunités en termes de visibilité, de mise en réseau ou de ressources financières ils véhiculent aussi une vision normative de ce que doit être « l’entrepreneure idéale ». Nombre de programmes reposent sur une logique d’empowerment individuel, invitant les femmes à renforcer leur confiance en elles, à développer leur leadership ou à concilier plus efficacement vie professionnelle et personnelle. Cette orientation, très présente dans les discours institutionnels, s’inscrit dans une rhétorique postféministe qui valorise la responsabilité individuelle et invisibilise les rapports structurels de pouvoir. Les inégalités systémiques, qu’elles concernent l’accès au financement, la place dans les réseaux d’affaires ou les stéréotypes de genre persistants, se trouvent ainsi reléguées au second plan.
Du côté des entrepreneures, ce cadrage suscite des réactions ambivalentes. Certaines y trouvent un appui concret, notamment en matière de visibilité et de légitimité, qui peut représenter un levier dans un environnement encore largement masculinisé. Mais beaucoup expriment aussi une forme de distance, voire de désillusion, face à des dispositifs qui leur semblent formatés et éloignés de leurs réalités quotidiennes. Ce que demandent en priorité les entrepreneures que nous avons rencontrées, ce ne sont pas tant des ateliers de développement personnel ou des campagnes de communication, mais un accès facilité aux financements, une reconnaissance de la diversité de leurs parcours et un soutien adapté aux contraintes spécifiques de leurs projets et territoires.
Autrement dit, l’entrepreneuriat féminin tel qu’il est promu par les politiques publiques repose souvent sur un imaginaire étroit, celui d’une entrepreneure performante, confiante et capable de surmonter seule les obstacles. Cette figure héroïsée, bien qu’inspirante pour certaines, peut renforcer le sentiment d’inadéquation pour d’autres, en particulier celles qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle. Ce décalage entre attentes et représentations produit un effet paradoxal : au lieu de réduire les inégalités, certaines politiques risquent de les reproduire, voire de les accentuer, en légitimant une vision partielle de l’entrepreneuriat des femmes.
Cet « écart » n’est pas seulement symbolique, il a des conséquences concrètes. Par exemple, les critères d’évaluation des projets dans certains dispositifs privilégient les trajectoires jugées ambitieuses et fortement tournées vers la croissance rapide, ce qui correspond davantage à des modèles entrepreneuriaux masculins dominants. À l’inverse, des projets ancrés dans des logiques de proximité, de durabilité ou de conciliation entre sphères de vie, plus fréquents chez les femmes selon nos observations, se voient moins bien valorisés. En cherchant à « réparer » les entrepreneures pour qu’elles se conforment aux standards existants, on occulte la nécessité de transformer en profondeur ces standards eux-mêmes.
Faut-il alors conclure à un rendez-vous manqué ? Pas nécessairement, mais notre recherche invite à reconsidérer la manière dont les politiques publiques sont conçues et mises en œuvre. Plutôt que de chercher à adapter les femmes aux normes entrepreneuriales dominantes, il s’agirait de reconnaître la diversité des pratiques et des aspirations, et d’agir sur les structures qui freinent l’égalité. Cela suppose de repenser les critères de financement, d’ouvrir davantage les dispositifs aux projets qui sortent des logiques de croissance rapide, et de travailler à la transformation des représentations sociales qui pèsent sur les trajectoires des femmes.
L’enjeu est de taille : il ne s’agit pas seulement de compter plus de femmes entrepreneures, mais de créer un environnement où leurs projets, quels qu’ils soient, puissent trouver leur place et être reconnus à part entière. Cela implique aussi de dépasser une logique communicationnelle qui met en avant des figures exemplaires, pour s’intéresser aux réalités plurielles et souvent plus discrètes de l’entrepreneuriat au féminin.
En définitive, nos résultats invitent à un changement de perspective. Soutenir l’entrepreneuriat des femmes ne peut pas se réduire à une succession de programmes incitatifs ou de campagnes valorisant quelques parcours emblématiques. C’est un travail de fond qui exige d’interroger les normes, les critères et les représentations qui structurent le champ entrepreneurial. À défaut, le risque est bien celui d’un rendez-vous manqué : beaucoup de moyens mobilisés, mais un impact limité sur les inégalités que ces politiques prétendent combattre.
Pauline Gibard et Marie-Christine Chalus-Sauvannet
Références bibliographiques
Gibard, P., et Chalus-Sauvannet, M.-C. (2025). Le grand écart : Analyse des discordances entre les attentes des femmes entrepreneures et les politiques qui leur sont dédiées en France : Management & Prospective, 41(2-3), 144-166.