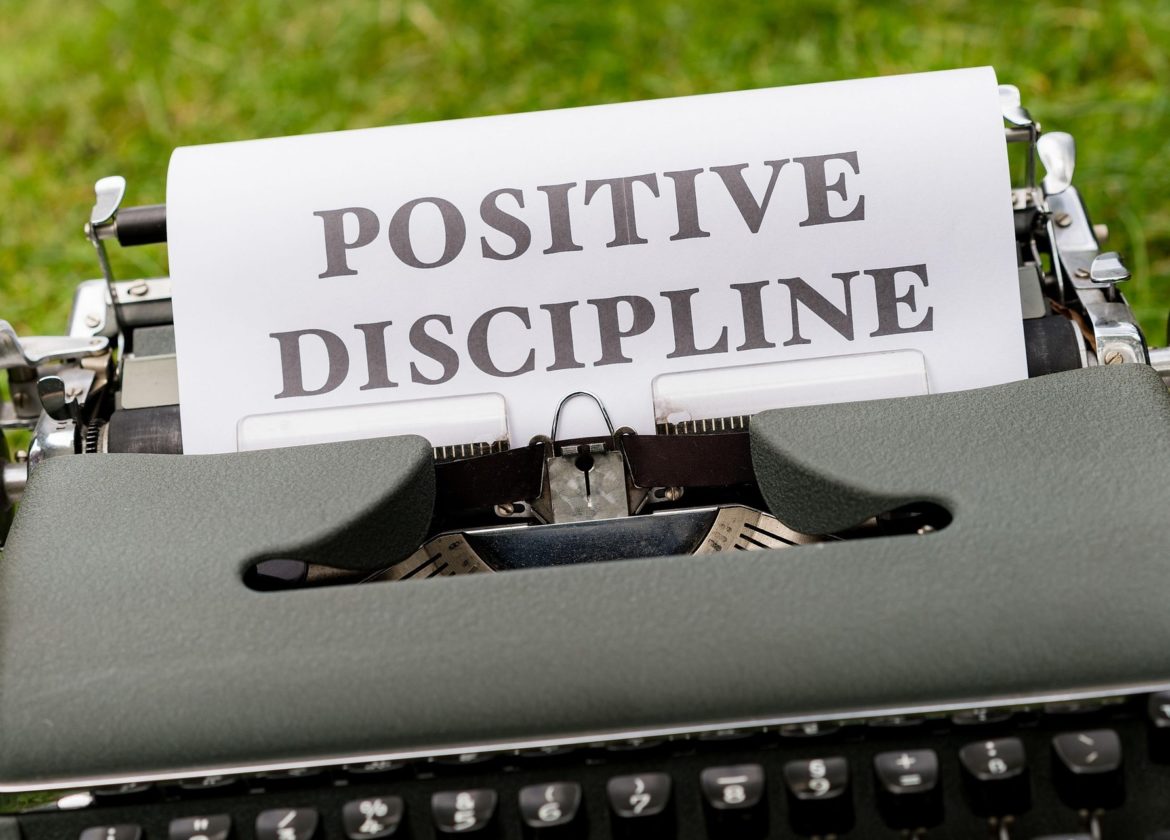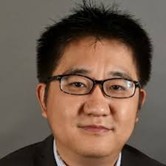Face à l’urgence écologique et à la nécessité d’accélérer la transition vers des technologies plus durables, les politiques publiques cherchent à favoriser l’innovation environnementale. Cependant, pour être efficaces, ces politiques doivent être cohérentes, ambitieuses et bien conçues. Comme le montre la littérature sur le policy design (Ashford et al., 1985), plusieurs éléments sont déterminants : la clarté des objectifs, la flexibilité des instruments, mais surtout la sévérité de la réglementation. Dans le contexte de l’innovation verte, la sévérité réglementaire désigne le niveau d’exigence imposé aux entreprises pour réduire leur impact environnemental. Cette sévérité peut se manifester par des objectifs de réduction très ambitieux, des coûts élevés de conformité avec les technologies existantes, ou encore la nécessité de changements technologiques profonds (Ashford et al., 1985). Pour autant, ce n’est pas seulement la sévérité « réelle » qui compte : ce qui importe aussi, c’est la manière dont elle est perçue par les acteurs économiques, notamment les entreprises et leurs clients. Les recherches empiriques et théoriques ont montré que la perception de la sévérité joue un rôle tout aussi fondamental que la sévérité objective. Lorsque les entreprises croient réellement à la menace d’une future interdiction ou d’un durcissement de la réglementation, elles sont plus enclines à anticiper et à innover (Segerson and Micelli, 1998). En particulier, la crédibilité de la menace réglementaire est essentielle pour fixer des objectifs ambitieux dans les accords volontaires ou les dispositifs incitatifs. Mais cette crédibilité repose souvent sur l’équilibre entre rigueur et réalisme. Une réglementation trop souple est facilement contournée, tandis qu’une réglementation trop sévère peut être vue comme irréaliste, ce qui affaiblit son pouvoir incitatif (Ashford et al., 1985). Le règlement européen REACH, qui encadre les substances chimiques, est un bon exemple pour analyser ces dynamiques. Bien qu’il ait été conçu pour encourager le remplacement des substances les plus dangereuses, sa mise en œuvre repose sur une logique flexible et évolutive, notamment via la procédure d’autorisation et l’obligation de recherche d’alternatives techniquement et économiquement viables. Cette flexibilité, si elle permet une adaptation progressive, peut également affaiblir la perception de la sévérité. Les entreprises pourraient ainsi retarder leurs efforts d’innovation en se contentant d’améliorations incrémentales (CSES, 2012), surtout si elles doutent de l’imminence ou de la crédibilité d’une interdiction.
La perception réglementaire guide la transition technologique
Nos travaux (Arfaoui et al. 2014 ; Brouillat et al., 2018 ; Brouillat and Saint Jean, 2020) mettent lumière un résultat clé : la sévérité perçue a un rôle décisif surtout lorsque la sévérité objective est faible. Dans les cas où la réglementation est objectivement sévère, cette sévérité suffit à elle seule pour stimuler la transition technologique. La perception joue un rôle secondaire. En revanche, dans des contextes réglementaires plus souples, la sévérité perçue par les clients devient le moteur principal de l’innovation. Lorsqu’ils croient fortement à une future interdiction d’une technologie polluante, ils se tournent vers des alternatives. Cela pousse les fournisseurs à innover, même sans obligation directe (effet de « demand pull »). À l’inverse, si seuls les fournisseurs perçoivent une forte menace réglementaire mais que les clients restent attachés à la technologie polluante, la transition s’enlise. Les fournisseurs négligent les améliorations de la technologie polluante (technologie encore autorisée), et la diffusion des alternatives propres ne compense pas ce manque, entraînant in fine des performances environnementales inférieures au scénario sans réglementation.
Perception hétérogène selon les acteurs
Par ailleurs, nos travaux soulignent que la perception de la réglementation peut varier selon la position dans la chaîne de valeur. Les clients finaux, souvent plus exposés aux pressions sociales ou réglementaires, peuvent anticiper des changements que les fournisseurs, moins informés ou moins exposés, sous-estiment. Cette asymétrie peut créer des tensions ou des désalignements dans les efforts d’innovation.
Renforcer la croyance des clients et la crédibilité des alternatives
Dans ce contexte, deux grandes implications politiques se dégagent : Premièrement, renforcer la perception de la sévérité chez les clients peut avoir un effet déclencheur sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Par exemple, l’étiquetage environnemental pourrait rendre plus visible la dangerosité de certaines substances et accroître la perception de leur probable interdiction future. Il contribuerait également à une classification plus rapide des substances préoccupantes (notamment les perturbateurs endocriniens). Deuxièmement, renforcer la crédibilité des alternatives est essentiel. À travers des projets de démonstration, des plateformes technologiques ou des subventions ciblées, les politiques d’innovation peuvent à la fois soutenir les fournisseurs dans leurs efforts de transition et rassurer les clients sur la faisabilité et la viabilité des solutions de substitution.
Références bibliographiques
Arfaoui, N., Brouillat, E., & Saint Jean, M. (2014). Policy design and technological substitution: Investigating the REACH regulation in an agent-based model. Ecological Economics, 107, 347-365.
Ashford, N., Ayers, C., & Stone, R. (1985). Using regulation to change the market for innovation. Harvard Environmental Law Review, 9(2), 419–466.
Brouillat, E., Saint Jean, M., & Arfaoui, N. (2018). “Reach for the sky”: modeling the impact of policy stringency on industrial dynamics in the case of the REACH regulation. Industrial and Corporate Change, 27(2), 289-320.
Brouillat, E., & Saint Jean, M. (2020). Mind the gap: Investigating the impact of implementation gaps on cleaner technology transition. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120145.
Segerson, K., & Miceli, T. J. (1998). Voluntary environmental agreements: good or bad news for environmental protection?. Journal of environmental economics and management, 36(2), 109-130.
CSES (2012). Evaluation of the REACH Regulation and Review of Certain Elements: Final Report.